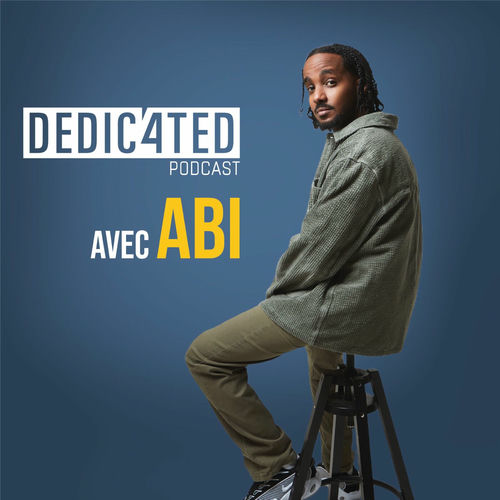Pour la première fois depuis 1990 aucun morceau de rap ne figure dans le Top 40 du Billboard Hot 100. Trente-cinq ans d’hégémonie effacée, plus une trace de hiphop dans ce classement avec la sortie de Kendrick, victime de nouvelles règles. Partir avec du Lamar… ce n’est pas rien. Le chant du cygne d’un genre qui se libère après avoir servi de vache laitière à la machine pop. La fin d’un cycle, enfin !
Le rap a conquis l’empire, il est même devenu l’esthétique dominante d’un capitalisme culturel qui recycle tout ce qu’il touche. Mais à force, il a fini par y perdre son âme, à ne parler que pour se vendre. Les majors ont compressé son énergie dans des formats identiques. Couplet court, refrain viral, beat standardisé. Les plateformes ont remplacé les producteurs, les algorithmes sont devenus les nouveaux djs, le public s’est peu à peu lassé d’une musique pensée pour le marché plutôt que pour l’art. Ce que l’on voit aujourd’hui n’est donc pas la mort du rap mais celle de sa version industrielle, de ce hip-pop qui se vend comme un produit ménager. Alors ce n’est pas un genre musical qui disparaît du Top 40, c’est une marchandise.
L’absence du rap dans ce classement n’a rien d’une crise artistique, c’est une panne du système. Pendant des années, les majors ont vidé le hiphop de sa substance, le réduisant à une mécanique de clics. Chaque single devait être viral avant d’être vital. Les labels ont confondu performance et pertinence. La musique a cessé d’être un espace de création pour devenir une cellule dans un tableau Excel. Heureusement, toute économie fondée sur la saturation finit par s’effondrer. Le streaming, qui promettait la liberté, a fabriqué l’uniformité. Et quand tout se ressemble, plus rien ne résonne. La chute du rap dans les charts n’a rien d’une tragédie, au contraire, c’est le signe d’un sevrage collectif, d’un refus d’alimenter la machine.
Le rap ne s’efface pas, il s’affranchit
Trente-cinq ans de présence continue au sommet avaient transformé le rap en institution. Il n’avait plus le droit d’échouer, ni même de se taire. Aujourd’hui, il s’offre un luxe que le marché déteste : une pause, une saison hors des projecteurs. Une respiration qui doit redonner de l’air aux marges, aux labels indépendants, aux collectifs, aux artistes qui créent sans stratégie marketing. Sur Bandcamp ou SoundCloud le rap retrouve sa fonction, sociale. Témoigner, dénoncer, raconter ce que l’industrie n’a jamais voulu légitimer. Moins visible, mais plus libre. C’est là que renaît l’invention, loin des budgets, proches des réalités.
Le hiphop retourne à sa source, celle d’une économie artisanale, fraternelle, qui fait avec ce que le système lui laisse mais en aucun cas pour en devenir le valet. On peut alors se dire que si le rap n’est plus dans le Top 40 c’est peut-être qu’il est enfin vivant à nouveau. Il ne quitte pas un espace de pouvoir, il y revient. Il retourne vers ce dehors d’où il vient. Celui des communautés, du vécu, de la liberté. Un retour qui n’a rien d’une régression, c’est une réparation. Le rap reprend la rue, l’indépendance, l’informel. Tout ce que la logique marchande lui avait confisqué. Ce n’est pas une disparition, c’est un exil volontaire (coucou Makala). Et dans ce mouvement il peut enfin retrouver son ADN, celui d’un art collectif, politique, profondément indocile.
La plupart de mes classics n’ont jamais figuré dans le Top 40
Sortir du Top 40, c’est refuser la hiérarchie imposée par le capitalisme culturel. C’est dire « Je n’ai plus besoin de ton classement, de ta validation, pour exister ». Le rap, en quittant la scène de la consommation de masse, retrouve son souffle, celui des voix qu’on n’entend pas. Ce n’est pas seulement un geste musical, c’est un geste social, politique. Il redonne au hiphop sa fonction critique, sa puissance de contre-récit. Là où les chiffres imposent la conformité, le silence impose la réflexion. Le Top 40 perd son roi, le rap retrouve sa république.
Ce qui se joue aux États-Unis résonne déjà ici. On en perçoit les prémices dans la scène francophone où la nouvelle pop française s’éloigne des codes hérités du rap pour explorer d’autres textures, renouer avec ce qui faisait la force de sa variété d’hier. Mélodie, texte, sincérité. Des artistes, même issus de téléréalité comme la Star Ac’, semblent refuser les contraintes du single algorithmique et remettent au centre la narration, la voix, le temps.
Le rap francophone, lui, se fissure et ses failles ne peuvent plus être masquées. Et si d’un côté celles et ceux qui veulent encore presser le filon jusqu’à la saturation sont partout (une simple écoute des titres les plus streamés suffit à s’en convaincre), en marge, une autre énergie circule. Celle d’un rap qui se réinvente, qui refuse de plus en plus frontalement de se plier aux codes du système. Ouf.
Dans ces fissures, on entend déjà la promesse d’une musique redevenue libre, indocile, indéchiffrable. Celle qui refuse de se compter pour mieux se faire entendre. Celle d’un rap qui cesse d’imiter la rentabilité et recommence à inventer le monde de demain. Ce rap qu’on a tant aimée.
Mr Seavers